
Crime et châtiment: Simon Liberati écrit sur la « peur de tuer »

Le meurtre de l’actrice Sharon Tate en 1969 est au coeur de deux romans formidables. Alors qu’Emma Cline (The Girls) choisit d’escalader le fait divers par la face la plus métaphorique, Simon Liberati (California Girls) s’attaque, lui, au versant le plus abrupt, le plus sordide. Il s’en explique.
Après un éloge baroque et habité consacré à sa femme Eva Ionesco, dont l’ombre sulfureuse de celle qui fut le jouet érotique des fantasmes de sa mère, la photographe Irina Ionesco, l’accompagne depuis près de quarante ans, Simon Liberati se penche dans California Girls sur l’un des faits divers les plus célèbres de l’histoire criminelle des Etats-Unis. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, trois filles et un garçon s’introduisent dans une propriété luxueuse de Beverly Hills et y assassinent les cinq personnes se trouvant sur place, dont l’actrice enceinte Sharon Tate, femme de Roman Polanski. Cette affaire marquera durablement les esprits. Par l’horreur des crimes mais aussi par sa force symbolique: les auteurs sont de jeunes gens ordinaires, envoyés en service commandé par leur gourou, l’illuminé Charles Manson, qui a profité de l’esprit libertaire de l’époque pour laisser proliférer ses démons intérieurs. Prenant le parti d’une écriture clinique, avec la scène du meurtre comme matrice, le romancier français a fait un pari audacieux mais payant. Le voyeurisme se dissout dans une expérience physique et cérébrale intense qui en dit plus long sur l’acte de tuer que des heures de propagande djihadiste.
Deux romans sur l’affaire Manson, étrange coïncidence, non?
J’avais déjà écrit les 140 pages de la scène principale du crime en 2013. Mais j’ai mis le projet de côté parce que j’ai rencontré Eva et que j’ai eu envie d’écrire sur elle. Et aussi parce que l’affaire Polanski venait d’éclater. Mais quand on a appris que le Emma Cline allait sortir, je m’y suis remis pour ne pas arriver après elle.
Pourquoi avoir choisi de raconter ces 36 heures cruciales en particulier?
Au départ, j’avais envisagé d’écrire sur le moment où ces filles vont dans le désert après les meurtres. J’étais intéressé par l’après. Mais il y a peu de renseignements sur cette période, pendant laquelle elles vont d’ailleurs rapidement se séparer. Le meurtre a été une déflagration qui a fait exploser la « famille ». Il m’a semblé intéressant de me concentrer sur le détonateur.
Avez-vous des souvenirs de l’époque?
Tous les gens de ma génération ont été frappés par ce crime. Il a eu un retentissement phénoménal. La presse du monde entier en parlait. Notamment à cause de la personnalité des victimes. En particulier de Sharon Tate, une femme très belle, dont je savais qu’elle avait joué dans Le Bal des vampires. Quant à Polanski, il avait une sacrée réputation. Son Rosemary’s Baby avait fait du bruit. Je n’avais que 9 ans mais les curés de l’école en avaient parlé. L’un d’entre eux était allé le voir en pensant que c’était une comédie musicale (rires). Cette histoire de diable était donc dans l’air du temps. Alors vous imaginez, le meurtre d’une femme enceinte plus la personnalité du tueur et des filles, vous aviez tous les ingrédients d’un fait divers de grande ampleur.
Cet événement marque-t-il la fin du rêve hippie?
Je nuancerais un peu. Dès la fin de l’été 1967, au moment du Summer of Love, les gens qui se trouvaient dans le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco ont commencé à sentir de très mauvaises vibrations. Très vite, des types mal intentionnés se sont incrustés à la communauté, attirés par la libération sexuelle, avec l’idée d’en tirer profit. L’innocence que l’on prête aux hippies avait déjà pris un coup dans l’aile au moment de l’affaire Manson. On l’oublie parfois mais les gens étaient violents à l’époque. En comparaison, la jeunesse d’aujourd’hui est finalement assez cool. Manson n’est qu’un voyou parmi d’autres qui s’est intégré au flower power et à cette espèce de kermesse idéaliste. Or, on sait qu’il y a toujours des embrouilles dans les kermesses…
Vous laissez entendre que Manson était et est toujours protégé par la police…
Je m’avance peut-être un peu mais il faut bien s’avancer de temps en temps. Le policier qui n’a pas transmis les informations qui auraient permis l’arrestation immédiate de la bande était aussi celui qui a servi à monter des fausses preuves contre un Black Panther. Manson était très obsédé par les Black Panthers, on a donc dû le laisser faire à un moment… L’a-t-on manipulé? Certainement pas jusqu’à faire assassiner Sharon Tate mais il y a dû y avoir de la tolérance à son égard.
Quelle est la part de frustration personnelle dans son projet, lui qui espérait tant devenir une star de la musique?
Manson nourrit une haine profonde et définitive pour l’ordre social. Il considère que la société l’a maltraité, qu’il n’a pas eu droit à la moindre protection de l’Etat. Cette idée est très ancrée en lui parce qu’il a été en prison dès l’âge de 12 ans. Sa mère était prostituée et alcoolique. Il a le profil type du serial killer, du sociopathe. Sa lutte viscérale contre les Noirs est la superstructure de sa paranoïa mais la vérité c’est qu’il veut entraîner ceux qui l’entourent dans l’enfer des prisons américaines, et leur voler ce qu’il n’a jamais vraiment eu : la liberté. C’est son moteur profond.
Ces filles manipulées qui assassinent froidement, ça fait penser aux terroristes d’aujourd’hui. Est-ce la même dynamique selon vous?
C’est vrai que dans l’attitude de ces filles on devine cette vertu particulière, et universellement partagée, des adolescents à faire n’importe quoi par idéalisme, quel qu’il soit. Même si le vrai criminel de l’affaire, c’est Tex Watson, le garçon du commando. C’est lui qui a tué. Il avait une personnalité criminelle qui s’est réveillée au contact de Manson. Mais celui-ci avait préparé le terrain, il faisait faire des jeux de rôle aux filles, leur demandait de s’introduire dans les maisons la nuit pour déplacer des objets. Cette préparation peut faire penser à ces garçons qui se frottent d’abord à la délinquance avant de se retrouver soudain propulsés dans des situations extrêmes. Le parallèle s’arrête toutefois là. Le projet Manson est un projet pervers. Il veut commettre des crimes pour faire accuser d’autres, les Noirs en l’occurrence, et déclencher une situation dont il tirerait profit dans l’avenir.
Grâce à ma sensibilité d’artiste, je peux expliquer ce que ça signifie de tuer quelqu’un, au sens organique.
Vous vous basez sur des informations vérifiées. Où situez-vous la limite entre le roman et le docu-fiction?
Les faits sont disponibles pour tout le monde sur le Net mais, dans un roman, grâce à ma sensibilité d’artiste, je peux expliquer ce que ça signifie de tuer quelqu’un, au sens organique. Ce que ça fait, par exemple, de planter un couteau dans un corps, ce qui n’est pas facile. C’est ça le sujet du livre. Eh non: regardez, j’étale les intestins de Sharon Tate, regardez les horreurs que je raconte. J’ai écrit sur la peur de tuer. La forme littéraire permet par le langage d’entrer dans une forme de critique intellectuelle de ce qu’est vraiment un acte. Là où l’image ne pourra pas vous donner ce recul. Quand Isis montre des exécutions à la chaîne de prisonniers, au bout d’un moment on a l’impression de voir des pastèques qui éclatent. Vous regardez cinq fois et ça ne vous fait plus rien. C’est le principe de la pornographie.
Pourquoi cette affaire est-elle entrée dans la mythologie américaine? Kubrick s’en est inspiré pour Orange mécanique, une série télé récente, Aquarius, s’en fait également l’écho…
Je crois qu’il y a un rapport particulier entre Hollywood, et Los Angeles en général, et Satan. Le satanisme à Los Angeles a toujours été très présent. On peut l’observer dans l’influence de Scarface sur la mise en scène des snuff movies colombiens. Manson est une de ces personnalités de l’étoile noire et son aura a grandi de manière extraordinaire au fil du temps. En 1969, Manson est considéré comme un petit gourou minable, un drogué qui a entraîné des jeunes dans la drogue et les a poussés à commettre des crimes. Après, on l’oublie, les gens retournent aux concerts des Beatles et des Rolling Stones. Mais, petit à petit, cette figure qui appartenait à l’under contre-culture remonte à travers différents prismes, comme le cinéma de John Waters ou comme le mouvement punk, qui reprend le sourire narquois d’Orange mécanique, lui-même inspiré de la mimique de Susan Atkins (NDLR: lieutenant de Manson).
Votre regard sur la nature humaine a-t-il changé après vous être frotté à cette histoire sordide?
J’ai longtemps pensé que la corruption ne pouvait engendrer que de la corruption, une idée qui imprègne mon premier livre, Anthologie des apparitions. Mais depuis que j’ai rencontré Eva, en voyant d’où elle venait et où elle était arrivée, je me suis dit qu’il y avait une possibilité de rédemption. C’est vrai pour Eva, ça peut donc l’être aussi pour les Mansoniennes. Elles sont passées par le pire et certaines s’en sont sorties, comme Katie ou Leslie, qui ont eu des vies exemplaires en prison une fois qu’elles ont avoué leurs crimes et manifesté leurs regrets.
Avez-vous lu The Girls, le roman d’Emma Cline?
J’ai lu les extraits qui ont circulé au moment des enchères. J’ai vu qu’on avait des points communs car la matrice est identique. Mais nos livres sont très différents. Elle a fait un vrai travail d’écriture au sens romanesque, en prenant par exemple des libertés avec les faits. Alors que moi j’ai abordé le matériel de manière plus brute. Je doutais d’ailleurs un peu de mon premier jet sur la scène du meurtre. Mais quand j’ai lu Emma Cline, je me suis dit : bon, puisque je suis là où elle n’est pas allée, autant continuer même si je dois tremper les pieds dans le sang jusqu’au bout, je ferai le sale boulot…
Si le lecteur ne devait retenir qu’une chose de votre livre, ce serait quoi?
Cette phrase de Susan Atkins, qu’elle a réellement prononcée et que je crois sincère, où elle dit que quand elle a tué Sharon Tate, elle a senti que quelque chose mourrait en elle. Je pense que quand vous commettez cette transgression majeure, il y a une perte de sensibilité, quelque chose qui meurt définitivement en vous.
Simon Liberati utilise l’affaire Manson pour interroger le mal absolu tandis qu’Emma Cline en fait le terreau d’une fresque lyrique sur les tourments de l’adolescence. Double ration de plaisir.
Deux romans pour un seul sujet, n’est-ce pas un de trop? Non. A l’autopsie, California Girls de Simon Liberati comme The Girls d’Emma Cline méritent notre attention et nos applaudissements. Illustrant la puissance et la richesse de la littérature, les deux écrivains malaxent la même pâte vénéneuse – l’assassinat sauvage de Sharon Tate et de quatre autres personnes présentes dans sa propriété de Beverly Hills une nuit d’août 1969 par un quatuor majoritairement féminin téléguidé par le gourou Charles Manson – mais aboutissent à deux romans diamétralement opposés. Dans la forme mais aussi, plus étonnant, dans le fond.

L’auteur de Jayne Mansfield 1967 s’en tient en apparence aux faits, se concentrant sur les 36 heures où tout a basculé. Dans un style dépouillé, voire clinique, il y décrit la vie viciée du ranch californien où Manson et sa clique, des filles paumées pour l’essentiel, ont posé leurs loques, leur ennui et leur nihilisme. La crasse, le sexe et la drogue donnent à ce tableau des airs de royaume satanique. Avec, dans le rôle du guide spirituel, un lutin maléfique travaillé par une paranoïa délirante. A longueur de journée, il ressasse l’injustice dont il se dit victime de la part de Terry Melcher, l’impresario des Beach Boys, qui n’a pas honoré une vague promesse de lui faire enregistrer un disque. Un bourrage de crâne qui finira par déboucher sur une expédition punitive au 10050 Cielo Drive, sur les hauteurs de Beverly Hills. Sauf que Melcher n’habite plus à cette adresse. La villa est occupée par la femme de Roman Polanski, Sharon Tate, enceinte jusqu’aux yeux, et trois amis. Qu’à cela ne tienne, Susie, Katie, Linda et Tex ne font pas marche arrière pour autant. Leur but est de tuer le plus de « cochons » possibles. Pourvu que la police et les médias suspectent des Noirs, Black Panthers de préférence, d’avoir commis ces atrocités. Et c’est parti pour 140 pages de boucherie au réalisme parfois insoutenable, point d’ébullition de ce Mal que traque jusqu’à la moelle Liberati. En faisant circuler rapidement le point de vue d’un acteur à l’autre, le romancier dilate le temps et parvient à sublimer tout voyeurisme pour reproduire l’expérience physique et sensorielle du carnage, au plus près de l’animalité. On ne se contente pas pour une fois de regarder le meurtre dans son halo cathodique et magnétique, on le ressent pour ce qu’il est: une épreuve terrible.
Le grand frisson
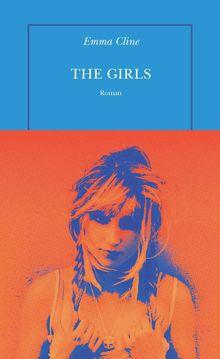
En comparaison, le premier roman de la Californienne Emma Cline a l’air presque inoffensif. Il file un coton plus lyrique, plus métaphorique. La cinquantaine, Evie Boyd se souvient de ses 14 ans quand, ne sachant comment attirer l’attention, elle fut aspirée par l’effronterie d’un trio de sorcières magnétiques gravitant autour de Russell. « Elles s’aventuraient le long d’une frontière tortueuse, entre la beauté et la laideur, créant dans leur sillage une onde d’agitation », écrit Cline. Pour les beaux yeux de Suzanne, la plus sauvage, la plus sexy de la bande, Evie va accepter les règles toxiques de cette communauté aux moeurs dissolues. La langue soyeuse de Cline caresse le regard. Plus que le mal, c’est la quête d’identité et les atermoiements de l’âge ingrat qui sont au centre des préoccupations de la talentueuse romancière.
Autant Liberati racle l’os, autant Cline travaille sur la surface émotionnelle, sur les sensations évanescentes, son roman laissant derrière lui un parfum de nostalgie et de mystère qui planait déjà sur le Virgin Suicides de Sofia Coppola.
> California Girls, par Simon Liberati, éd. Grasset, 342 p.
> The Girls, par Emma Cline, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean Esch, éd. La Table Ronde, 336 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici